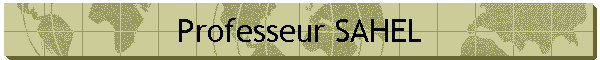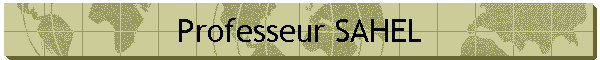Entretien avec…
José-Alain Sahel, Directeur scientifique de l’Institut de la Vision
Pourquoi avoir créé un Institut de la Vision ?
Il s’agit d’un Institut entièrement dédié aux recherches sur la biologie de
la vision et les maladies oculaires. Au sein du plus grand hôpital
ophtalmologique de France et même d’Europe, l’hôpital des Quinze-Vingts,
nous avons implanté un centre d’investigation clinique articulé à un centre
de référence pour les maladies rares. Nous avons construit un institut de
recherche multidisciplinaire où les chercheurs partagent des plateformes de
pointe et mutualisent leurs moyens entre équipes académiques et avec des
industriels implantés sur le site. En regroupant des chercheurs, je parle
même de chercheurs qui travaillent sur des sujets très fondamentaux, des
cliniciens et des industriels dans ce lieu d’interactions renforcées, chacun
se sensibilisera naturellement aux problématiques que rencontrent les
autres. Cet Institut coordonnera et rapprochera ainsi les différentes étapes
de la recherche dans le domaine de la vision.
Quels sont les atouts des centres de recherche tel que l’Institut de la
Vision ?
Notre système de financement crée malheureusement des murs difficiles à
franchir entre la recherche dite fondamentale et la recherche dite finalisée
ou encore entre la recherche académique et la recherche industrielle. Les
centres de recherche, comme la mise en place de réseaux, permettent de
franchir ces murs. En regroupant des compétences différentes sur un lieu
unique, avec des séminaires et des plateaux techniques communs, on peut
espérer ainsi aller un peu plus loin sur le chemin de la compréhension comme
sur celui des nouveaux traitements. Chaque métier a ses experts et chaque
expert a ses propres limites. Ce rapprochement géographique n’est qu’un
moyen d’encourager la mise en commun des expertises et de permettre de
conduire, plus facilement, une question d’un bout à l’autre du spectre de la
recherche biomédicale.
Comment va fonctionner cet Institut ?
L’Institut de la Vision a vocation à devenir un centre de recherche
Inserm-Université Pierre-et-Marie-Curie-Hôpital. Et selon l’esprit de
l’Inserm, les savoirs et techniques « translationnels » seront mis en
commun. Ainsi, tout en gardant leur autonomie de travail et de gestion, les
équipes de l’Institut échangeront leurs connaissances lors de séminaires
réguliers et travailleront sur des plateformes techniques communes comme
l’animalerie, le plateau d’imagerie… De nombreuses collaborations sont
également prévues, notamment avec l’Institute
of Ophtalmology de Londres, où j’occupe une chaire, de même que le
Professeur Battacharya, titulaire d’une chaire d’Excellence de l’ANR et
responsable d’équipe à l’Institut de la Vision. Nous accueillerons également
le professeur Don Zack de l’université Johns Hopkins et participerons à deux
réseaux européens (un programme intégré du PCRD6 de génomique fonctionnelle,
EVI-GENORET, et un ensemble de centres de recherches dit d’excellence,
European Vision Institute Sites of
Excellence). Une équipe formée en collaboration avec le CNRS, de
l’Observatoire de Paris, travaillera sur l’imagerie à haute résolution de la
rétine. Enfin, dans le cadre du RTRS, « Voir et entendre » coordonné avec
Christine Petit, une approche concertée du handicap sensoriel sera conduite.
Comment avez-vous recruté les équipes de recherche ?
L’appel d’offres a été lancé en France mais aussi à l’étranger par l’Inserm,
l’université Pierre-et-Marie-Curie et l’hôpital, sous forme d’une annonce
parue dans la revue Nature. Cette
démarche nous a semblé importante afin de limiter le risque que l’Institut
soit modelé sur le schéma intellectuel de ses fondateurs. Un jury
international a ainsi sélectionné les équipes indépendamment des axes que
nous pensions voir développés au sein de l’Institut. De fait, des équipes
ont été recrutées en dehors de ces axes. Cette démarche s’accorde avec
l’image que j’ai du monde du vivant où l’imprévisible laisse émerger ce qui
sera ensuite sélectionné. L’approche que nous avons eue pour recruter les
équipes de l’Institut de la Vision laisse ainsi la possibilité à cet «
organisme » d’évoluer au fil du temps.
De quels projets prometteurs pouvez-vous nous parler ?
Plusieurs projets sont très encourageants et les efforts des équipes de
recherche porteront notamment sur la biologie du développement avec les
travaux sur les cellules souches, mais aussi la génétique et la modélisation
des maladies. Sans oublier les thérapies cellulaires, géniques et
pharmacologiques des maladies rétiniennes dont la dégénérescence maculaire
liée à l’âge et les maladies génétiques font partie. Mentionnons aussi les
approches pharmacologiques dérivées des connaissances de la
neurotransmission, essentielles au développement des prothèses rétiniennes.
En effet, quelques projets comme celui de la rétine artificielle vont
certainement profiter de la visibilité de l’Institut et bénéficier ainsi
d’un « coup d’accélérateur ». Nous espérons mettre en place prochainement
les premiers essais cliniques. Le projet concernant le facteur RdCVF, une
protéine de survie des cônes, devrait lui aussi atteindre bientôt les phases
d’essai clinique dans le cadre d’un partenariat industriel avec Fovea-Pharma,
une spin-off de notre laboratoire.